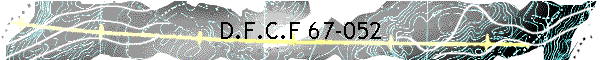
|
|
|
|
D'une main, Catherine de Dietrich désigne le portrait peint d'un homme en perruque accroché au dessus de la cheminée de l'immense salle à manger parquetée. « Regardez, d'ici il peut apercevoir sa forge. » Tournant la tête vers la fenêtre, la jeune femme indique de l'autre main le vallon qui recueille, comme des reliques précieuses, les vestiges de l'usine. C'est ici que, sous l'impulsion de Jean de Dietrich, le personnage du tableau, commença une saga de maîtres de forge. A Jaegerthal, il ne reste que quelques pierres des ateliers qui, au-delà d'une fonte et d'un acier réputés, bâtirent une dynastie à laquelle Louis XV conféra la particule de la noblesse. Le nom des de Dietrich s'inscrit même dans l'histoire politique. Philippe Frédéric, le fils de Jean, est devenu le premier maire de Strasbourg sous la Révolution. On le voit chanter la Marseillaise avec Rouget de l'Isle sur le célèbre tableau de Pils. Une profession de foi qui ne l'empêchera pas de mourir décapité. Une péripétie parmi tant d'autres qu'on peut tirer d'une histoire mouvementée s'il en est, celle de la maison de Dietrich. Loin des soubresauts de la Révolution, à l'abri des tensions des guerres. Marc-Antoine de Dietrich, 39 ans, apprécie la vie à Jaegerthal, dans un château contruit en 1780. Les fleurs disparuesLe parc du château de Jaegerthal ouvre une trouée au milieu de la grande forêt qui part de Reichshoffen pour monter en pente régulière vers les collines des Vosges du Nord. Mais le privilège des châtelains s'apprécie d'autant plus qu'il se fait rare. Trop rare, distillé au fil de quelques week-ends et d'un mois en été. En effet, c'est à Paris, en appartement, que vit la famille de Dietrich. Noblesse oblige, on devine l'appartement confortable.« Mais nous n'avons qu'une petite terrasse, avec de la verdure cependant », précise Catherine. Descendants d'une lignée d'industriels, les de Dietrich disent apprécier la nature. Alors, ces courts séjours alsaciens sont les bienvenus. Ils permettent de retrouver, avant même le château, ce parc d'herbe épaisse habité d'arbres séculaires. Les deux dernières générations de barons en date ont volontiers les doigts verts. On se hâte, sitôt les valises défaites, de revêtir l'habit de jardinier. Sur 40 ha, il y a de quoi s'occuper. Avec les services d'un employé, le parc est majestueux. Pourtant, résigné ou nostalgique, Marc-Antoine évoque une période révolue : « Du temps de mon père, fait-il en montrant la bordure de la terrasse, c'était autre chose. Il y avait des fleurs partout. » Quelques fleurs qui ne sauraient cacher la grande forêt dont le groupe De Dietrich vient de se séparer. « C'est sans doute le dernier changement de taille, explique Marc-Antoine ( le groupe a cédé au début de l'été les 4 600 ha dont il était propriétaire). Cette vaste possession était représentative de notre ancrage dans la région. Mais, vous savez, dans le cadre d'une entreprise moderne, elle ne se justifiait plus. » L'héritier de Dietrich fait une confidence : « C'est une chance que les bois aient pu être revendus à un propriétaire unique. Le morcellement a pu être évité ». Des poêles aux autosLa forêt était consubstantielle à l'entreprise. Ce n'est pas un hasard si les forges, grandes mangeuses de chaleur, se sont installées dans les contrées boisées. De Dietrich se sépare de sa forêt. L'avatar revêt une forte portée symbolique, marquant les esprits. Mais bien plus significative est la restructuration menée par le groupe De Dietrich depuis dix ans. « Tout remontait à une même origine, raconte Marc-Antoine, il y a eu la fonte, puis l'acier. » Et puis De Dietrich est devenu, au temps de la grande industrialisation, l'histoire incarnée d'une diversification industrielle exemplaire. Une aventure moderne partie des taques de cheminée pour arriver aux wagons de chemin de fer en passant par les poêles en fonte, les escaliers. La firme joua aussi, avec succès, au constructeur automobile. Plus que la route, c'est le rail qui portera la force du groupe. « Le ferroviaire a été le dada de mon grand-père, Dominique, » continue Marc-Antoine. Aujourd'hui, il n'est pas exagéré de soutenir que la notoriété du matériel ferroviaire roulant à nourri la fierté de milliers d'ouvriers sur des générations. Alors, comment s'étonner que la cession, en 1995, de l'usine ferroviaire de Reichshoffen à Alstom ait été ressentie comme un coup de poignard par les ouvriers. Marc-Antoine reconnaît le malaise engendré chez les personnels de la « Schmelz », l'usine de Reichshoffen. Ce sont autant de familles dont les hommes avaient toujours travaillé pour un nom qui se sont senties abandonnées. Marc-Antoine évoque un sentiment de trahison chez tous ces gens. Catherine renchérit : « Le mot de trahison n'est pas exagéré, dit-elle. Il a toujours existé un lien affectif entre les propriétaires et les ouvriers. » Marc-Antoine reprend : «Les gens qui viennent chez nous se sentent bien, que ce soit à la base ou aux responsabilités. Je pense qu'ils perçoivent une éthique, une façon différente de faire le choses. Les employés apprécient l'histoire qui est derrière leur entreprise» ... Extrait de l'article DNA "les Barons du fer" de Claude Robinet (octobre 1999) © Tous droits réservés 2002 - SCHMITT Bernard (Reichshoffen)
Consulter le carnet de trafic en .PDF
|
|
|